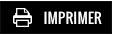Les ouvrier.es ne peuvent pas faire les frais de la guerre tarifaire de Trump
Le 2 avril, l’administration Trump a annoncé l’augmentation des droits de douane sur l’importaion de produits de pays du monde entier. Les annoncés à des pays producteurs textiles tels que le Cambodge, le Bangladesh, le Sri Lanka, l’Indonésie, le Lesotho et le Vietnam signifient que le secteur serait lourdement affecté par ces mesures. Le réseau Clean Clothes Campaign dont le Collectif Ethique sur l’Etiquette est la branche française demande aux entreprises donneuses d’ordre de veiller à ce que les coûts n’en soient pas répercutés sur les plus vulnérables de ce système, les ouvrier.es.
Les secteurs textiles de ces pays sont dominés par les commandes de grandes entreprises américaines qui ont des activités internationales, telles que Victoria’s Secret (6,2 milliards de dollars de recettes en 2024), Levi’s (6,4 milliards de dollars), PVH (Calvin Klein) (8,7 milliards de dollars), Gap (15,1 milliards de dollars) ou Nike (51,4 milliards de dollars). En outre, de nombreuses usines dans les pays concernés appartiennent à de riches groupes industriels opérant dans toute l’Asie du Sud et du Sud-Est, tels que Mas Holdings - basé au Sri Lanka mais actif dans le monde entier - qui pèse près de 800 millions d’USD. Les coûts engendrés par la politique tarifaire américaine devraient être comprises dans les marges de ces entreprises, plutôt que d’être répercutés en aval de la chaîne d’approvisionnement.
Les entreprises du textile devraient veiller à ne pas répéter les erreurs de la pandémie de Covid, quand les multinationales du secteur, face à l’adversité, n’ont donné la priorité qu’à la rentabilité, accablant encore des millions de travailleurs, alors empêchés de travailler, déjà employés avec des salaires de misère.
Dans de nombreux pays où des droits de douane élevés ont été annoncés, comme le Cambodge, le Sri Lanka et le Bangladesh, les travailleurs sont déjà payés à des niveaux inférieurs au seuil de subsistance et n’ont pas d’épargne sur laquelle s’appuyer. Toute nouvelle tentative des entreprises de dégager les mêmes marges sur les travailleurs en baissant les prix de commande, en réduisant les salaires, en augmentant le nombre d’heures supplémentaires non rémunérées ou en mettant en péril des emplois par la délocalisation de la production, aura pour effet de réduire encore les moyens de subsistance des ouvier.es et les contraindre à l’endettement.
Les premiers signes d’abus de la situation pour réduire les coûts et faisant reculer les droits des travailleurs sont déjà visibles. Les marques donneuses d’ordre, telles que Gap, Walmart et Levi’s, auraient déjà commencé à exiger des réductions de prix ou - ce qui revient au même - à exhorter leurs fournisseurs à supporter l’intégralité de la charge des droits de douane. Comme les prix actuels sont déjà insuffisants pour garantir aux travailleurs des salaires vitaux et des conditions de travail acceptables, il est clair que le prix de ces réductions forcées sera finalement payé par les ouvrier.es. Par ailleurs, les fédérations d’employeurs de plusieurs pays producteurs de vêtements ont déjà commencé à brandir la menace des répercussions et sont tombées dans le piège de l’encouragement du dumping vers le bas. Sous la menace d’une délocalisation des emplois vers d’autres pays moins touchés par les droits de douane, la tentation de réduire les salaires et d’augmenter les prix des produits de base est d’actualité. Il est important que les travailleurs des pays producteurs de vêtements s’unissent dans une approche commune pour y faire face collectivement.
Plusieurs pays touchés par les droits de douane, comme le Cambodge, le Sri Lanka et l’Indonésie, ont pris contact avec le gouvernement Trump pour négocier. Au Sri Lanka, un comité de crise a même été formé ; il ne compte dans ses rangs que des représentants des employeurs et du gouvernement. Il est primordial que les syndicats, en tant que premiers représentants des personnes potentiellement les plus touchées par ces mesures, siègent dans les concertations, en particulier lorsque leurs employeurs y participent déjà.
À la suite de la pandémie de Covid 19, au cours de laquelle des travailleurs du monde entier ont perdu leur emploi ou n’ont pas reçu leur salaire intégral en raison des choix d’entreprises donneuses d’ordre, la confiance des travailleurs et de leurs syndicats dans les entreprises et les employeurs être est, à juste titre, considérablement affaiblie. Par exemple, une proposition des syndicats de constituer un fonds de garantie visant à assurer que les travailleurs soient indemnisés s’ils perdent leur emploi en temps de crise a, jusqu’à présent, été rejetée par les marques.
Il est illusoire de penser que ces mesures, si elles voyaient le jour, aboutiraient à une relocalisation de la production, même si, comme nous le souhaitons, elle devenait plus raisonnable en volume. Compte tenu de la course à la rentabilité des grandes entreprises du secteur, de leur volonté ancrée des donneurs d’ordres de ne supporter aucune des responsabilités liées au management d’un grand nombre d’ouvriers, mais aussi des investissements massifs que cela nécessiterait, le niveau de salaire et de protection des ouvriers américains, l’hyperspécialisation dans les pays producteurs etc.
Quel que soit le résultat de ces annonces, elles ont eu un retentissement délétère sur les oouvrier.es et leurs organisations et démontré la fragilité des pays producteurs tant qu’ils n’adoptent pas une stratégie collective.
Celles et ceux qui survivent avec des salaires de misère ne doivent pas payer la facture des déclarations et décisions erratiques du chef de l’Etat américain pour des entreprises massivement rentables.